Extraits de mes ouvrages
Extrait de :
"Avant de mourir une dernière fois"
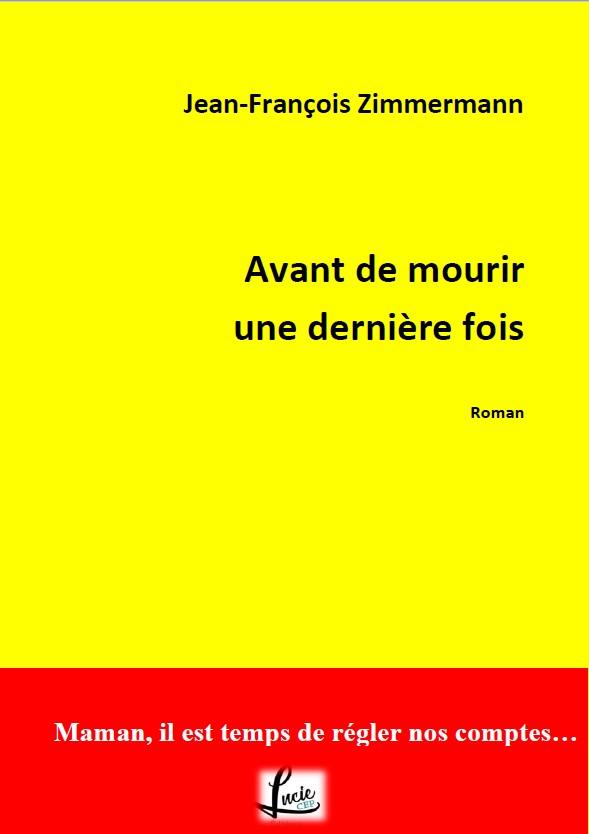
Ma mère avait la jouissance bruyante.
Dans notre appartement parisien, donc antérieurement à 1956, date de la cessation des activités parisiennes de mon père et de notre départ pour la Bretagne, mon lit d’enfant était installé dans la vaste chambre de mes parents séparé de la vue sur leur propre couche par un petit retour de cloison et une armoire Louis-Philippe.
J’ai été ainsi, durant toute ma prime enfance, bercé par les chants de Cupidon et intrigué par les passages successifs de mes parents dans la salle de bain. Au tintement de sa lourde chevalière contre la faïence, je devinais que mon père utilisait le bidet.
Plus tard, en Bretagne, de ma chambre située à l’étage supérieur, je perçus encore ces plaintes enamourées.
Mon père en fut d’abord l’artisan puis, après sa mort, elles furent l’œuvre d’Albert Hourdin, son amant, ce grand vantard, poseur et sûr de lui, adjudant à la retraite et représentant de commerce. Son histoire sera évoquée plus longuement dans les prochaines pages.
Les rugissantes étreintes qui ponctuèrent ces coucheries me furent insupportables. Elles m’emplirent de honte et de haine à l’égard de ma mère qui n’avait même pas eu la décence de respecter le temps du deuil.
Ses autres sigisbées ne me furent heureusement pas imposés dans la demeure familiale.
Un entrepreneur en maçonnerie, un directeur de banque, l’exploitant d’une carrière de granit et enfin, un charbonnier montèrent à l’assaut de cette femme qui, malgré l’approche de la cinquantaine, conservait encore de beaux restes.
En l’absence de ses vagissements habituels, j’ignore s’ils la firent jouir de semblable manière.
Je souhaitais la mort de chacun d’entre eux.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Extrait de :
"Les 4 sorcières de Bouvignies"
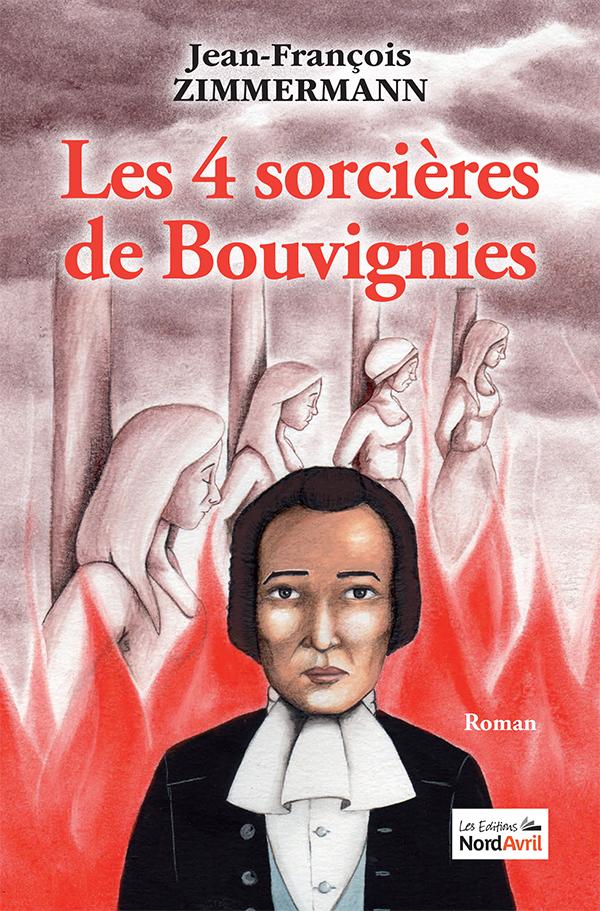
- Vous vous aimez, vous vous aimez, la belle affaire ! Nous ne sommes pas à Versailles, nous sommes à Bouvignies ! Ici, on marie un pré à un champ, un verger à un jardin, des chevaux à des vaches. On s’additionne pour faire une nouvelle famille. On se marie entre gens d’un même état et on fait des enfants. A-t-on besoin d’aimer pour copuler ?
Antoine et Marie-Anne échangent un regard consterné. Andrieu se dit qu’il l’aimait bien, lui, sa Péronne avant de l’épouser. Et il a la faiblesse de croire que c’était réciproque. Alors, il comprend les enfants.
Péronne, les mains sur les hanches, la tête hardiment dressée, est prête à affronter toutes les contradictions. Si les années et les grossesses successives ont un peu gâté sa taille, elle a encore fière allure. Elle sortait à peine de l’adolescence lorsqu’elle s’est mariée. Son époux avait dix ans de plus qu’elle, il était le maître. Mais, le temps passant, la volonté de Péronne s’est affirmée.
Lorsque, quelques instants auparavant, les deux jeunes gens sont entrés, elle préparait la soupe. Sans se retourner, elle a dit : « Laissez vos sabots à l’entrée, je viens de garnir le sol de paille fraîche, il ne s’agit pas de me la souiller », manière pour elle de les désarçonner et d’affirmer son autorité.
Andrieu se risque à prendre leur défense.
- Antoine sait lire, et s’il a peu de biens, il a des bras solides et du courage. Il sera homme de fief et saura se faire sa place dans notre village.
- Et tu as lu ça dans les astres, Andrieu ?
Il hausse les épaules.
- D’habitude, c’est plutôt toi qui fais des prédictions !
- Des prédictions, tu parles ! On raconte n’importe quoi et ceux qui écoutent prennent la chose toute musquée ! Tiens, avant-hier encore, Pierre-François, le fils de Jean Moreau, est passé devant chez nous pour mener sa bête au marais. Marie-Anne était avec moi, n’est-ce pas Marie-Anne ?
Elle opine du chef en souriant. Lorsqu’elle sourit, une fossette apparaît sous sa pommette gauche. Ce petit creux plait beaucoup à Antoine.
- Et il me dit en faisant le fier et en regardant ta fille avec effronterie : « N’est-ce pas que ma vache, elle est belle ? ». Je lui ai répondu pour me moquer : « Méfie-toi du mauvais œil ! ». Hier, Jean Moreau est venu. J’étais toute seule. Il était furieux. « Méchante femme, m’a-t-il dit, sais-tu ce qu’il est arrivé à Pierre-François ? », « Comment veux-tu que je le sache ? », « Tu dois le savoir, puisque tu lui as jeté un sort. Au marais, il jouait au bâton avec son frère et le bâton lui a sauté dans l’œil. Il a l’œil crevé. Tu lui as bien dit de se méfier du mauvais œil, non ? », « Ben oui, je l’ai prévenu de s’en méfier. S’il avait tenu compte de mon avertissement, il n’aurait pas joué avec un bâton ». Il est reparti en grommelant après m’avoir montré le poing.
Elle retourne près du foyer car la soupe bouillonne et menace de déborder. Elle coupe de larges tranches de pain qu’elle dispose à plat au fond de chaque assiette placée sur la table, puis se penche sur le chaudron dans lequel elle plonge une louche et arrose la tartine de la première assiette.
Elle dit :
- Allez, Antoine, pour que tu te rendes compte que je ne suis pas si mauvaise, veux-tu partager la soupe avec nous ? Elle est bien maigre, on n’a plus grand-chose à se mettre sous la dent, c’est la fin de l’hiver. Les légumes de printemps n’ont point encore poussé et ceux de l’hiver sont épuisés. Marie-Anne, va t’en quérir deux ou trois œufs au gélinier, il y aura bien quelques poules plus courageuses que les autres qui auront pondu ! Cela épaissira un peu la soupe.
Andrieu enchérit.
- Oui, c’est vrai qu’on a cru un moment qu’on n’aurait pas suffisamment de réserves pour attraper le bout de l’an.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Extrait de :
"L'île de la Liberté"
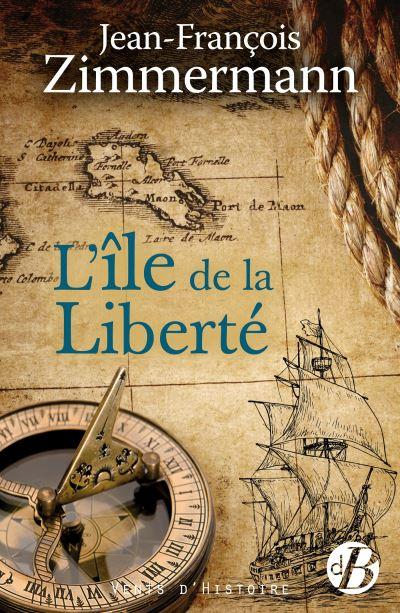
...
L’une des îles-champignons, la plus grande, est la préférée de Martin. Il s’y rend avec une des trois barques à fond plat que les charpentiers ont construites en utilisant le bois de l’épave de la passe éponyme. Le séjour prolongé dans l’eau de ce matériau en a profondément affecté la qualité, mais pour une navigation limitée au lagon, cela est bien suffisant. Six places, pas de rames, juste une godille pour en assurer la propulsion. Martin attend la marée haute pour l’aborder. Il a équipé l’île d’une échelle de corde pour descendre sur le sable lorsque la mer est basse. Tout rond, son petit domaine mesure une centaine de pas de diamètre. Il est situé à trois lieues du village. En profitant du reflux, il faut au jeune homme une heure et demie pour y parvenir.
Martin apprécie particulièrement ces instants de solitude qui l’autorisent à ôter son masque sans crainte d’effrayer les oiseaux ou les poissons ! Il profite du flux pour se laisser porter en amont et du reflux pour revenir jusqu’à son île en prenant garde à ne pas la dépasser car le courant que Louis Fournier a estimé, après l’avoir mesuré, à environ six nœuds pourrait l’entraîner au-delà de la passe. Il n’a nulle envie de se retrouver en pleine mer !
Il a pris l’habitude de nager en compagnie d’énormes poissons de toutes formes, tous aussi étranges les uns que les autres et aussi curieux que lui-même d’examiner de plus près l’être mystérieux qui vient hanter leurs profondeurs. Cette familiarité ne l’effraie point. Il caresse ces peaux lisses, parfois veloutées, avec délicatesse. Il suit l’ombre projetée sur le sable d’un poisson plat, large de plus de deux toises et long de la moitié, qui meut ses vastes draperies avec lenteur. Il semble plus voler que nager. Chacun de ses mouvements est empreint de grâce et de distinction. Son ventre est blanc nacré et son dos bleu foncé. Aux deux côtés de sa grande gueule, qu’il ouvre comme s’il voulait respirer, il enroule par instants deux petites nageoires supplémentaires jusqu’à en former deux tubes. Martin se demande bien quelle peut en être l’utilité[1].
Ces moments de solitude sont un réel bonheur pour le jeune homme qui éprouve un sentiment intense de liberté à l’instar de ces animaux silencieux qui deviennent ses compagnons. Il se nourrit d’écrevisses de mer, grosses comme le poing et longues d’un pied, tigrées de jaune et de brun[2], qu’il fait cuire dans un récipient empli d’eau de mer. Repu, il songe à son état présent et au futur de l’île de la Liberté, rêve à la dimension d’un homme, Olivier de L’Aubertière, épris de justice et d’indépendance. Il s’interroge sur les réelles motivations de dom Feyo et de Paul. Il ne parvient pas à les imaginer tous deux finir leurs jours sur cette île isolée du reste du monde. Il tente d’imaginer cette république lorsque ses citoyens seront établis en couple, avec des enfants. Auront-ils encore, chevillé au corps, cet esprit d’aventure qui les a jusqu’à présent animés ? Ne seront-ils pas tentés de préserver ce qu’ils auront acquis, douceur de vivre, femme et enfants ? En un mot, ne risquent-ils pas de s’amollir et de devenir vulnérables car il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’un jour ou l’autre ce coin de paradis sera découvert et deviendra l’objet de la convoitise de plus d’un malfaisant ? Sera-t-il tolérable pour les "Grands de ce monde" qu’une république libre et indépendante, généreuse et tolérante, puisse exister et ainsi démontrer à leurs propres sujets la vanité de leur gouvernement ?
[1] Martin folâtre en compagnie d’une raie Manta. Les ailerons qu’il évoque servent au poisson à ramener l’eau en direction de sa gueule pour se nourrir du plancton.
[2] Gambas de Madagascar. Au XVIIème siècle, on n’identifiait pas encore les différentes espèces de crustacés. ..
"Le Roi des Halles, mémoires secrets du Masque de fer"

À Philippe, mon cher neveu.
Le temps s’étire, interminable. Les heures glissent, muettes et inutiles. Devant mes yeux fermés, défilent les épisodes de la vie, ô combien mouvementée, mais jamais futile, d’un gentilhomme soucieux de justice, plus à l’écoute de la voix du peuple que de celle de ses pairs, coutumiers des courbettes et des compromissions.
Je regarde passer le cortège mélancolique des jours enfuis. À présent, les nuits frileuses s’enfoncent dans la douceur ouatée de ma mémoire. Mes souvenirs, flocons paresseux, tournoient, hésitent quelques instants encore avant de se poser pour fondre et disparaître.
Durant ces années d’enfermement, j’ai cru que la porte de ma geôle s’ouvrirait un jour sur la liberté. Convaincu d’une méprise, mon geôlier implorerait mon pardon. Passé ce temps, et avant celui de la résignation, j’ai songé à m’évader. Autrefois, Mazarin m’avait serré à Vincennes. J’y ai patienté cinq longues années avant de m’en échapper et de reparaître, en plein Paris, au beau milieu des Frondeurs, impuni. J’avais l’appui du peuple, j’étais intouchable. Je pouvais braver l’autorité royale.
Aujourd’hui, c’est le temps de l’oubli. Je croupis dans l’épaisseur de la nuit qui noie ma pensée. Les jours s’ajoutent aux jours, qui s’assemblent en semaines, se combinent en mois et s’empilent en années. Personne ne m’a signifié les motifs de mon incarcération. Suis-je victime d’une tragique erreur judiciaire ? Certes, des ennemis, je n’en manquais pas, mais je n’en vois aucun me haïr au point de me condamner à cette mort lente, à ce pourrissement du corps et de l’âme. « Garde-toi de tes amis » conseille ce vieil adage. Même de ce côté, une telle trahison me paraît impossible.
Il m’est strictement interdit de communiquer avec l’extérieur sous peine de mort. J’ai demandé à monsieur de Saint-Mars, qui reçoit régulièrement la Gazette, de me tenir informé des événements du monde. Il a refusé, prétextant que Louvois s’y opposait. Durant les premières années de mon incarcération, j’ai écrit moult lettres, tant au roi qu’à la reine et au ministre, monsieur de Louvois. Mon valet les glissait à monsieur de Saint-Mars pour qu’il se chargeât de les leur adresser. Je leur demandais, je les suppliais de m’éclairer sur les motifs de ma détention. Ils ne m’ont jamais répondu. Je présume qu’aucun n’a eu connaissance de ces lettres, le gouverneur appliquant strictement les consignes qui m’interdisaient de communiquer avec quiconque.
J’ai toujours entretenu de bons rapports avec monsieur de Saint-Mars. Nous avons ensemble passé un pacte à mon arrivée à Pignerol. Il m’a clairement fait comprendre ce qu’il attendait de moi.
« Nul ne doit avoir connaissance de votre nom. Vous êtes ici au secret. Il vous est interdit de tenter d’entrer en relation avec quiconque. Les gardiens, le porte-clefs, monsieur Rû, le médecin, l’aumônier toqueront fortement la première porte de votre cellule avant de s’annoncer et n’entreront qu’après avoir entendu votre réponse. Ils attendront dans l’entre-deux portes le temps que vous placiez votre masque sur votre visage et que vous les autorisiez à ouvrir la seconde porte, puis la troisième. Sachez que si vous dérogiez à cette consigne, ils risqueraient d’en perdre la vie ».
J’ai donc respecté mes engagements.
Au fil des ans, monsieur de Saint-Mars, qui partageait en quelque sorte mon absence de liberté, fut victime d’un profond accablement. Bien qu’il bénéficiât des largesses de monsieur de Louvois sous la forme de rentes et de libéralités s’élevant à plusieurs milliers de livres par an qui s’ajoutaient à ses émoluments de gouverneur, il souffrait de plus en plus de la monotonie de cette vie de caserne. Considérant qu’il pouvait me faire confiance, il m’accorda la fourniture de papier, de plumes et d’encre. Sur les crédits que l’État lui octroyait pour les frais occasionnés par mon séjour, il prélevait une part qu’il consacrait à l’achat de livres que je lui commandais. Ma cellule en fut vite encombrée. Plutôt que de les lui rendre, il exigeait que je les brûlasse car il craignait que je ne fusse tenté d’y glisser quelques feuillets ou annotations de mon cru.
Les livres mentent. Les philosophes s’accrochent à la réalité pour tenter de nous transmettre, de nous expliquer leur vision du monde. Les historiens arrangent à leur manière les faits du passé pour nous mettre en garde contre les impostures de notre présent. Quant aux poètes, ils inventent des pays où nous n’habiterons jamais.
J’ai décidé alors d’entreprendre la rédaction de mes mémoires et de confier à ma plume la liberté de donner audience à mes souvenirs. Au travers de ces lignes, je remâcherai ma vie et en porterai à ta connaissance, mon cher Philippe, les épisodes que d’aucuns, dans leur propre intérêt, ont celé à l’Histoire.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
"Rendez-vous au Pré-aux-Clercs"

« Paris, le quinzième de novembre de l’an 1643
À Charlotte Philbert
Ma chère cousine,
Me voici séquestré, le mot n’est pas trop fort, depuis la Saint-Luc, dans ce collège. À la suite d’une algarade avec mon père, celui-ci, en matière de représailles, m’a fait entrer au collège de Beauvais, non en tant qu’externe, mais en tant que pensionnaire. Après qu’il m’aura fait étudier ici durant deux années, il me fera entrer au séminaire.
À mon arrivée, il m’a fallu me dépouiller de mes hardes et revêtir la longue robe violette des pensionnaires. Il fait encore nuit noire lorsque la cloche nous somme de nous lever. Il est alors cinq heures. Les paupières encore soudées par le sommeil, il faut se lever, ouvrir son lit et montrer au surveillant que l’on n’a pas sali son drap.
À cinq heures et quart la prière commune nous rassemble à l’église. Elle dure une demi-heure. Nous rejoignons ensuite la salle d’étude jusqu’à sept heures. Après la récitation des leçons, nous déjeunons. De huit heures à dix heures, nous avons cours puis nous dînons. Nous bénéficions ensuite d’une récréation jusqu’à midi. D’une longue récréation car le dîner, fort frugal, est vite avalé ! Ensuite, classe de l’après-dîner jusqu’à quatre heures et demie, un petit quart d’heure de détente et étude jusqu’à six heures. Le souper est encore plus maigre que le dîner. Il est expédié en un quart d’heure ! Après une heure de récréation, heure que je consacre à t’écrire, ma chère cousine, nouvelle étude, puis récitation des leçons. Un quart d’heure de prières précède l’extinction des feux à neuf heures. Nous dormons dans des chambres communes.
Quelques privilégiés fortunés ont un logement particulier qu’ils partagent avec leur valet. Dois-je te préciser que je n’en fais pas partie ? Mon brave Binet s’en est retourné au château car la pension que m’octroie mon père est insuffisante à son entretien. J’ai commis l’imprudence de me rebeller, il m’a puni.
Pour la première fois de ma vie, j’ai faim. Il semblerait aux pères jésuites que l’ascèse soit indispensable pour étudier. Il me semble à moi que les araignées ont tissé leurs toiles entre mes dents ! Heureusement, il y a le jeudi. Si nous ne sommes pas punis, nous bénéficions d’une autorisation de sortie pour la journée… après la messe, bien sûr ! Nous devons être de retour pour la prière du soir. Je profite de cette journée pour faire bombance dans une auberge avec plusieurs camarades. Nous retrouvons l’usage de la parole après six jours de silence imposé. Je vois d’ici tes yeux s’écarquiller et tes lèvres mutines s’arrondir. Hé oui, nous sommes tenus de respecter la règle du silence, comme moines en monastère. Nous sommes traqués jusque dans notre intimité par le préfet des mœurs et le préfet des chambres qui assistent le principal. Les Jésuites, qui ne sont point gens ordinaires, ont imaginé de renforcer notre assujettissement en créant les décurions. On se croirait figurer dans une légion romaine ! À tour de rôle chefs de décurie, nous assurons ce rôle d’auxiliaires des régents. Le décurion doit être zélé, arriver le premier en classe, faire réciter les leçons et même noter les écoliers ! Il doit dénoncer les paresseux ! Et je ne t’ai pas encore tout dit. Les Jésuites, militaires dans l’âme, distribuent grades et responsabilités. Le famulus ouvre les portes des classes, s’occupe de ranger les bancs et tient à jour le tableau des confessions. Au censeur sont confiés le cahier des absences, des retardataires et la liste des écoliers interrogés. Le vigile, quant à lui, est l’espion de service, l’infâme dénonciateur. Tous ces responsables sont élus par nous-mêmes, sauf ce dernier qui est directement nommé par un Père, régent.
Voilà, ma chère cousine, ma nouvelle vie. Pour le présent, j’en ris. Je crains que lorsque cette hilarité m’aura quitté, je ne m’en accommode point.
Me manquent la tendre complicité de nos ébats nocturnes, mes longues chevauchées avec mon fidèle Pégase, mes promenades dans la campagne bourguignonne, mes assauts en salle d’armes, les chasses avec Flèche, mon lévrier infatigable.
Pendant que je me morfonds céans, François est chargé d’assurer la descendance de la famille car il va bientôt se marier ! Il est des tâches plus rebutantes ! Mais telle est l’injuste condition du cadet, condition dont je ne me satisfais point.
Mes parents ne me donnent aucune nouvelle. Pas la moindre lettre depuis mon incarcération. Quant à François, il a d’autres chats à fouetter, ou d’autres chattes à flatter !
J’attends ta réponse dans la plus grande impatience. Elle sera le miel de ma pauvre existence. »
Raphaël de Courcelles
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Quelques extraits de :
LE MEPRIS ET LA HAINE , parution prévue le 15 février 2016

Ils sont une centaine à s’être rassemblés avant l’aube dans la clairière de l’arbre aux pendus. Indignés par l’énormité de ce crime perpétré sans motif apparent, ils ont chacun leurs raisons de s’être déplacés pour assister à l’exécution du condamné. Certains sont là parce qu’ils étaient familiers de la victime, d’autres parce qu’ils n’ont encore jamais vu un homme se balancer au bout d’une corde, d’autres encore, accoutumés à ce spectacle, veulent éprouver une fois encore cette excitation sauvage qui leur fouaille les tripes. Ceux-là ne vomiront pas discrètement, ils écarquilleront leurs yeux pour ne rien perdre de la scène et jouiront dans leurs chausses.
Il n’y a que quelques vieux qui se souviennent d’avoir vu des misérables, la corde au cou, la langue pendante, battre des pieds la dernière mesure d’une muette complainte à l’ombre de l’arbre aux pendus.
La pluie ruisselle, tranquille et froide. Les chapeaux dégouttent sur les épaules recouvertes de capes plus ou moins rapiécées, plus ou moins tachées, plus ou moins élimées. Plusieurs chiens ont suivi leur maître. Trempés, ils grelottent, pitoyables, oreilles et queue rabattues. L’aube sort de la forêt et inonde la clairière. Le vieux chêne est là, en plein milieu, majestueux. La corde est accrochée à une haute branche. Une petite échelle est adossée au tronc. Deux hommes en armes assurent la garde de cette potence sylvestre.
Seul, à l’écart, Mathias Buson observe la scène. Ses énormes mains, râpeuses et poilues, tout en os et en muscles, deux grosses bêtes difformes, deux araignées à cinq pattes aux griffes jaunes frangées de crasse, sont posées sur le manche de la hache qui lui sert d’appui. Elles se crispent lorsqu’apparaît la charrette, tirée par deux chevaux, qui transporte le condamné. « M’est avis, qu’à tout prendre, il aurait préféré être suspendu à la vergue d’un vaisseau », commente Mathias, à voix basse.
Au brouhaha succède le silence. On aide à descendre Tout-en-poils qui, bien que muet désormais, a malgré tout été soumis à la question à la prison de Saint-Malo. Ses pieds brûlés par la torture ne peuvent plus le soutenir. « Privé de la parole, il n’a même pas pu se mettre en règle avec le Ciel », dit Mathias à voix haute. Plusieurs personnes se tournent vers lui. Le comte de Porcon, droit dans ses bottes, impassible, ignore l’intervention du forestier.
Sous le regard attentif du sénéchal Roland Briend, le bourreau passe la cravate de chanvre autour du cou du marin. Son appendice pileux a été coupé. Deux hommes sont désignés pour tirer sur la corde. Il s’agira d’une strangulation lente. Il ne mourra pas brutalement, les vertèbres brisées, mais lentement, étouffé. « Il va gigoter au bout de la corde », commente un connaisseur, « c’est la danse du pendu », renchérit un autre.
On tire sur la corde.
Mathias fixe le comte dont le regard est rivé à ce corps agité de soubresauts grotesques. Dans l’assistance, certains rient, d’autres se détournent. Xavier regarde Mathias. « Le forestier sait des choses et monsieur le comte sait qu’il sait. J’en suis sûr désormais », pense-t-il.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Libertas
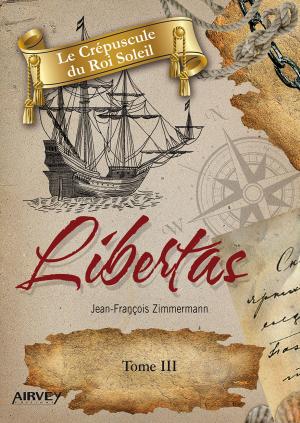
Déchirés par la cime du grand mât, des nuages cendrés filent en lambeaux. Le vent hargneux décoiffe les vagues écumantes qui sautent à bord sans y être invitées et qui s’étalent complaisamment en tentant d’investir le pont inférieur.
D’énormes lames se disputent le privilège de heurter en premier avec fracas la coque malmenée, fatiguée d’être l’objet de la fureur des flots. Tout craque, tout se brise, va-t-il rester une planche intacte ? Le gréement se tord, se détord et se rompt. Dans un terrible tonnerre, le mât d’artimon, cassé comme une allumette, s’abat sur le pont, entraînant tout sur son passage. Des matelots hurlent, courent en tous sens, se bousculent, trébuchent, se prennent les pieds dans les cordages, roulent sur le pont, s’affalent dans les voiles abattues. En aveugle, à tâtons, ils relèvent les blessés et les montent dans la chambre des officiers dont le plafond a été en partie crevé par la chute du mât, heureusement vers l’arrière, évitant ainsi d’entraîner le grand mât dans sa ruine. En un instant, Olivier a mesuré toute la gravité de la situation. Il donne ses ordres, serein. Chacun est rassuré, le capitaine a la situation bien en mains. Il suffit d’obéir. Au matin, on fera le bilan.
Et le lendemain, du sein de la tourmente naît un ciel serein, innocent comme le nourrisson. Les frisottis à la surface de la houle trahissent une mer encore émue de ses frasques de la veille.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ajouter un commentaire